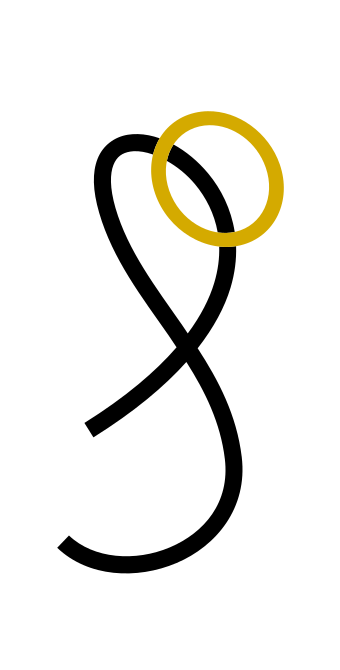Un lexique pour quoi faire ?
Je vous partage ce lexique psychologique et bibliographique. Il peut se présenter comme une volonté de transmission de ma part, un cairn qui indique, un témoignage de la navigation qu’implique la relation thérapeutique et la psychothérapie auprès de mes patients.
Il est réalisé et continue d’être alimenté par moi-même, au cours de ma pratique, de mes formations, et de mes lectures. N’hésitez pas à vous y arrimer.
Acting out :
Oury – A quelle heure passe le train ? – au sujet d’un jeune qui a brisé des fenêtres : « (…) sa façon de casser, tout seul oublié au fond d’un couloir, c’est un acting out, c’est à dire une demande insistante d’interprétation. Un acting out c’est pris dans le transfert, délimité par un scène qui suppose le transfert, ça se manifeste dans une dimension de monstration.
Addictions (vide/remplissage) :
C. Audibert : « (…) interroge la distinction entre le manque et le vide, avec le paradoxe du remplissage par le vide. Lacan dit qu’être seul, c’est désirer. Se remplir permettrait paradoxalement d’accéder au vide psychique. Subtil jeu inconscient entre le plein et le vide, les drogues viennent chasser les intrus. »
Aliénation :
F. Lordon – Interview Arrêt sur Images – : « L’aliénation est la désignation de la servitude passionnelle de l’autre, sans qu’on ne voit jamais la sienne propre. »
Anorexies/ Boulimies :
Manuel – Psychiatrie de l’étudiant – : (…) sont un symptôme ethnopsychiatrique ; elles expriment les problèmes non résolus d’une culture. Manger est un acte complexe, qui a de nombreuses dimensions :
-physiologiques : le corps a besoin d’aliments pour survivre (alternance faim/satiété)
-symbolique : manger = appartenir à un groupe, culture ; lien avec mère nourricière ou substituts (Terre-mère, etc.)
– hédonique : c’est un plaisir. Cela ramène aux satisfactions du stade oral -à zone érogène = bouche – et la relation d’objet passe par introjection ou dévoration.
Autisme :
C. Audibert : « (…) l’autisme peut nous aider à comprendre comment fonctionnent certaines drogues face à l’incapacité d’être seul. L’enfant autiste ignore sa dépendance aux autres, mais, ayant fabriqué lui-même son enveloppe extérieure pour se sentir exister et en sécurité, il devient dépendant dans le son contact avec les « sensations-objets ».
Autre :
S. Faladé –Le moi et la question du sujet -: « Du fait de la rencontre de l’Autre et de ses signifiants, lorsque le cri devient parole alors peut se manifester la première demande au lieu du Grand Autre, lieu du Trésor des signifiants ; un signifiant va décompléter cet Autre et ce signifiant qui décomplète cet Autre, ce sera le sujet. Le grand Autre préalable, est celui auquel on a affaire dès qu’on parle, qui se présente comme non barré et dont la castration va se faire connaître au fur et à mesure des demandes.»
« Le sujet barré c’est le $, c’est le signifié, celui qui pâtit du signifiant. »
Club :
Clinique de La Chesnaie – Les clubs de psychiatrie s’ancrent dans la loi 1901, sur le droit d’association. Ce droit non retirés aux aliénés comme y insistera F. Tosquelles.
La constitution et le fonctionnement d’un collectif contrebalance les effets péjoratifs de l’hospitalisation, les stigmatisations liées au seul diagnostic de maladie mentale.
Inscription reconnue (active / passive) de soignés et de soignants dans les schèmes d’échanges de la société, les possibilités de « commercer » tant à l’intérieur de l’établissement qu’à l’extérieur (…)
Du Fontbaré (Institutions n°36) – On pourrait croire qu’un Club ça sert à occuper les malades. Je ne crois pas que ce soit faux, à la condition que ce soit dans une dimension de surcroit, au sens où ne psychanalyse, on dit que la guérison vient de surcroit.
La question du sens (politique) est première, le Club apparaissant comme l’émergence politique d’un principe éthique. Il y a un rapport dialectique de ce minimum politique sociétal avec la disposition subjective de tous ceux qui veulent faire de la psychiatrie.
Il y a à s’autoriser (analyste, psychiatre, infirmier, malade) une alternative à l’obéissance aux idéologies en place. Je participe à la vie du Club non pas parce qu’il faut, mais parce que ça me concerne existentiellement. Je suis responsable d’autrui sans attendre la réciproque (… « la réciproque c’est son affaire. » Cf. Lévinas – Ethique et Infini). On pourrait même penser que moins il y aura de pouvoir émanant d’un chef ou d’une idéologie, plus il y aura de possibilités qu’il y ait du Club.
Oury (Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, p.62) – une compréhension plus totale n’est possible que si nous nous référons à un système plus général : le groupe dans lequel est l’individu, le Collectif de soins et sa relation avec la « société globale ».
Tosquelles, par Oury (1952) – « Le Club est en grande partie l’expression automatique de l’ensemble de l’hôpital, du fait qu’ayant un grand nombre d’activités propres, ces activités transcendent à la vie des quartiers (…) c’est la source de problèmes pratiques, l’occasion de conflits interhumains concrets, des activités « spontanées » de nombreux groupes et de l’établissement des liaisons vitales entre malades, infirmiers, personnels dans l’ensemble.
(…) c’est toujours une vue nouvelle qui crée des « besoins nouveaux » et avec ces besoins l’occasion de cette psychothérapie de groupe neutre et sociale, dont surtout les schizophrènes ont besoin. »
Oury – Différentiel du Club à la sociothérapie dans les services de sûreté :
« Dans les hôpitaux psychiatriques ordinaires, le Club sociothérapique, organe de la sociothérapie, a pour but d’émanciper par rapport aux autorités de tutelle les malades qui, vivant cette émancipation, s’opposent en force aux médecins et à l’administration. Dans la mesure où ils exercent leur initiative personnelle et s’engagent dans des situations(…) »
Clivage (objet/moi) :
Sigmund FREUD – texte de 1894, « Les psychonévroses de défense » –
« Les patients que j’ai analysés, en effet, se trouvaient en état de bonne santé psychique, jusqu’au moment où se produisit dans la vie représentative un cas d’inconciliabilité, c’est-à-dire jusqu’au moment où un événement, une représentation, une sensation se présenta à leur moi, éveillant un affect si pénible que la personne décida d’oublier la chose, ne se sentant pas la force de résoudre par le travail de pensée la contradiction entre cette représentation inconciliable et son Moi »
Cruauté :
Legraverand A.(JDP321) – « selon Freud, le sadisme, comme le masochisme impliquent une notion d’érotisation, un investissement libidinal, ce qui n’est pas le cas de la cruauté. »
« la violence du sujet cruel est souvent le fait d’une vengeance ou d’une recherche à faire partager sa propre souffrance, et se retrouver ainsi moins seul (R. Roussillon, 2002). »
La question de la sexualité est présente, mais secondaire, elle n’est qu’un moyen de se venger.
Constellation (transférentielle) :
P. Delion – « il ne s’agit pas de réunir un groupe qui prenne en charge tel patient pour parler de ce qui se déroule aux niveaux conscients et objectifs, bien plutôt de réunir de ce qui a pu ou peut être l’objet d’un investissement partiel du sujet en question, que ce soit les soignants qu’il apprécie, amis aussi ceux qui le persécutent, de façon à approcher les différents niveaux qui constituent la réalité psychique projetée du patient sur son entourage »
Contre-transfert :
M. Neyraut – le transfert – p.22 – (à propos du contre-transfert dans situation analytique) « l’implication, ne s’arrête point aux émotions, mais aux raisons de ces émotions, ou si l’on préfère au corps du délit. (..) La première des implications (…) celle d’être contraint de se concevoir comme l’objet des manifestations transférentielles pour saisir l’ampleur de cette implication. »
« dans la mesure où le transfert déplace avec lui de lourds charges affectives, le médecin se trouverait alors dans la fâcheuse nécessité de se reconnaitre comme l’objet de ses manifestations. Dès lors, on peut mesurer à la réticence qu’il éprouve ou à la difficulté qu’il ressent à « constater » la survenue de ces manifestations une certaine résistance déplacée maintenant du côté du thérapeute et l’obligeant à considérer cette résistance comme son fait propre. = autorise à concevoir un premier dessin du contre-transfert.
Le contre-transfert de l’analyste commence donc avec son implication, c’est parce qu’il se reconnait soudain comme objet et peut être déjà l’instigateur d’expressions affectives en provenance de son patient qu’il perçoit en lui l’effet d’une résistance. »
Culpabilité objective :
Oury – Séminaire « le collectif »- « Freud en parle (…) dans Malaise dans la civilisation (…) dans Problèmes économiques du masochisme . Freud précise que dans la culpabilité objective, il n’y a pas de « sentiment » de culpabilité, mais des manifestations. Ces manifestations peuvent apparaître dans différents registres. Cela avait été reprise en 1926-27 par Hesnard et Laforgue sous la dénomination de « processus d’autopunition », sorte de manifestations psychosomatiques, ou survenues d’accidents en rapports avec une situation. (…) cette culpabilité objective, Lacan la situe dans son rapport avec le désir : il y a culpabilité quand le sujet cède – c’est son expression- sur son désir. Ça peut paraître une ambiguité, « céder sur son désir » ; ç a ne veut pas dire satisfaire à son désir, au contraire : céder sur son désir, c’est ne pas aller jusqu’au bout de son désir, et même faire une manœuvre d’évitement. Autrement dit, céder sur son désir est un évitement. Parce qu’aller jusqu’au bout de son désir met en question le sujet dans son rapport au monde, et, en fin de compte, exige un courage extraordinaire ; il s’agit en effet de franchir les barrières, les menaces, de l’existence courante. Autrement dit, de ne pas éviter la castration. On peut ajouter à ça que céder sur son désir est d’autant plus facile qu’on ne cède que pour satisfaire quelque chose qui est justement recommandé par les structures professionnelles – – le « service des biens ». être justement à la hauteur, bien faire son travail, faire pour le mieux, que tout marche bien….
Conversion :
Nasio « L’hystérie », p.42 – Issue qui déjoue le refoulement (comme obsession ou phobie). Transformation de la charge sexuelle excessive en influx nerveux excessif, agissant comme excitant /ou inhibiteur, et provoque une souffrance somatique.
Du point de vue économique : transformation d’un excès d’énergie constant passant de l’état psychique à l’état somatique.
Manifestations : soit hypersensibilité, soit inhibition sensorielle/ motrice.
Nasio – « Le choix de l’organe dans la conversion : « l’hystérie actualise dans son corps l’empreinte psychique imprimée par le corps de l’autre. L’organe touché est lieu le plus près du trauma. »
Santé Mentale 209 – 2016 : A. Danis – dans la conversion, c’est le corps libidinal qui est atteint, c’est à dire l’image de son corps, la manière dont le sujet a investi son corps au plan libidinal. « La conversion est liée au traitement du conflit psychique par le refoulement. L’excitation (quantum d’affect), détachée de la représentation, est déplacée dans le corps. (…) si le processus réussit, la souffrance psychique disparaît, et c’est état-limite corps qui fait mal. »
Dépressif (Discours) :
Lambotte « Santé Mentale n°147 :«( …) sans doute le plus commun au sens où patient exprime son état de tristesse et d’apathie en fonction d’une cause déclenchant particulière. Peu importe qu’elle soit fantasmatique ou réelle, le patient est capable d’exprimer l’histoire de son malaise. Il s’adresse au thérapeute en une demande qu’il peut exprimer et en laquelle il croit. » La position de supposé savoir ici concourt à l’instauration d’une relation transférentielle.
Désir :
Saïet (2011) – Besoin et désir ne présentent pas le même type de fonctionnement (…) les objets de désir peuvent varier à l’infini ; ils ne sauraient jamais pleinement suffire. Les objets du besoin, relativement fixes sont au contraire pleinement satisfaisants.
Deuil :
Hanus, M. ( p.141) – le deuil est un mouvement régressif dont la profondeur et la durée sont variables (…), la régression va toujours jusqu’aux assises narcissiques, tout investissement objectal comportant une dimension narcissique.
(…) les sentiments inconscients de culpabilité sont ranimés car la disparition de l’objet entraine une désintrication pulsionnelle, une déliaison amour/haine investies sur ce même objet maintenant perdu.
(…) ce n’est pas l’amour qui nous fait tant souffrir (dans deuil) ; ou bien c’est le besoin, en tant qu’attachement prégénital, ou bien l’agressivité, habituellement les 2 associés.
P.144 – dans toutes les situations de séparation les désirs affectueux et hostiles ne sont plus liés du fait de l’absence de l’objet ; ils sont désintriqués. Les investissements positifs retournent vers le Moi, qui va souffrir de cette surcharge libidinale (car il n’est pas possible de réinvestir objectalement pour l’instant). Cependant, une bonne partie de ces investissements demeurent attachés à l’objet intériorisé et le détachement est progressif. Quant au devenir des investissements négatifs, hostilité,…, c’est lui qui en bonne partie va déterminer le cours et le destin du travail de deuil.
2 grands moyens d’apaisement de la culpabilité :
-culture du souvenir du défunt — réparer, soulager.
-imposition de restrictions au niveau des satisfactions (nous nous punissons indirectement) ; la souffrance de l’état dépressif = gage d’apaisement de la culpabilité
Freud, S. (1915) – (…) dans l’inconscient, la mort n’est jamais considérée comme naturelle, (…) on ne meurt pas, on est tué (externe). Cela permet de conserver tout au fond de soi l’illusion narcissique de pouvoir y échapper.
Hanus, M. (p.152) – (…) nous sommes toujours prêt à nous raccrocher à tout indice qui pourrait laisser subsister un doute sur cette réalité inacceptable d’emblée (besoin de dire au revoir, mais aussi voir, toucher, sentir). Tous ces signes vont nous aider à lutter contre nos tentatives de refus : « nous avons besoin de voir pour y croire ». (…) toutes ces pratiques collectives, vécues en étant bien entouré de leurs proches, donnent une consistance aux images internes du parent mort.
Freud (Deuil & et Mélancolie) :
Deuil = régulièrement la réaction à la perte d’une personne aimée ou d’une abstraction mise à sa place, la patrie, liberté, etc. l’action des mêmes événements provoque chez de nombreuses personnes, pour lesquelles F soupçonne de ce fait l’existence d’une prédisposition morbide, une mélancolie au lieu d’un deuil.
Deuil → inopportun et nuisible de le perturber.
Deuil = même troubles sans la perte de l’estime de soi. Même état d’âme douloureux, perte intérêt monde extérieur – dans mesure où celui-ci ne rappelle pas le défunt-, perte capacité de choisir nouvel objet d’amour –car remplacerait la personne aimée disparue-, abandon de toute activité qui ne soit pas en rapport avec le souvenir du défunt.
Deuils (périnatals)
Hanus, M. (Deuils dans la vie, p.160) – deuils particulièrement difficile (…) nous revoie aux significations que nos enfants ont pour nous, celles que cet enfant a pour nous, au-delà des sens universels que comporte la mater/paternité. Quel est le sens du désir d’enfant ? (…) tout deuil comporte une part de perte narcissique dès qu’il a une réelle importance. (…) l’ayant appelé à la vie, nous nous devions de l’amener au moins jusqu’à sa maturité, et de toutes façons il était aussi là pour nous survivre et voilà qu’il nous inflige l’affront de sa disparition anachronique.
(p. 161) – Freud l’avait indiqué que dans le deuil, nous souffrons davantage du futur commun qui s’effondre que du passé que rien ni personne ne peut nous retirer. (…) le deuil des tout petits, des pas encore né fait une terrible injure au futur qui aurait dû exister, qui existait déjà dans le désir des parents et qui ne peut plus exister !
(p. 164) – notre rôle d’intervenant auprès de ces femmes et tout membres de la famille nous donne de grandes responsabilités, car c’est la manière dont nous ressentons, investissons, parlons de ces petits être qui aident les parents, plongés en grande confusion…à les reconnaitre pour ce qu’ils sont, un de leurs enfants !
Dissociation, corps dissocié (schizophrénie) :
Oury « Le transfert », Psychothérapie institutionnelle n°8&9 1991 p.20 – (..) dans certaines formes de schizophrénies paranoïdes, le malade se projette par exemple dans une cruche, un briquet…il est clair que le briquet, à ce moment là il a pris une autre allure, ce n’est plus un simple briquet, il est pris dans un texte paranoïde, ou comme le dit M. Klein, dans une modalité de relation « schizo-paranoïde », à un niveau où il y a vraiment des défauts de « personnification », de « personnation » comme dit Winnicott ; où il y a des défauts dans la faculté d’habiter le corps.
Avec ce côté d’omnipotence et d’investissement partiel sur n’importe quoi – des personnes, des animaux, des objets- on est en plein dans le monde de la dissociation.
Ce qui typifie l’existence de la « personne du schizophrène », c’est la dissociation.
(…) Qu’est-ce que ça veut dire ?
Quand on parle à quelqu’un, on sent bien qu’il y a un point de rassemblement, il y a de l’unité. (…) chez un vrai schizophrène, on ne le sent pas…et en général, on ne s’y trompe pas. (…) on ressent quelque chose de l’ordre d’une étrangeté – comme si il y avait plusieurs points. Dans la dissociation, il y a plusieurs points de rassemblement, ou plutôt il n’y a pas de rassemblement. (…) il y a une sorte de dissociation du corps, donc de l’espace. Ç a rejoint ce que dit Gisela Pankow : que le corps dissocié, c’est aussi l’espace dissocié. Et il n’y a de possibilité d’accès au schizophrène que par l’espace. (…) il n’y a pas d’histoire possible avant qu’il y ait rassemblement. Pour construire une histoire, il faut d’abord être rassemblé : il faut qu’il y ait un nœud, pour que ça fasse unité. Or c’est justement ce qui n’existe pas chez le schizophrène.
Dissociation psychique :
(Cairn Que Sais-je – l’hypnose) – Janet – (…) sa théorie de la « désagrégation psychique » est la théorie qui explique le mieux état-limite proc de dissociation psychique tel qu’on peut l’observer dans les processus normaux aussi bien que pathologiques. Selon cette théorie, la conscience serait capable de se scinder en sous-parties (consciences secondaires) qui, dans certaines conditions, pourraient s’ignorer les une les autres. La conscience n’est alors plus globalement « pilotée » : c’est al dissociation.
(…) le psychologue Hilgard, s’appuyant sur les travaux de Janet, proposa de voir la dissociation comme un processus normal, y adjoignant la question de l’intentionnalité ( : le sujet peut choisir de vivre un processus dissociatif).
Discours :
Clastres, Guy. « Conférence sur les discours », Champ lacanien, vol. 11, no. 1, 2012, pp. 65-85 –
Les discours, « Pour Lacan, (…), c’est ce qui détermine les conditions de la parole. Ces discours constituent la réalité – ce que nous appelons la réalité – à notre insu ».
Chez Lacan, le discours, c’est ce qui fait lien social. « Si on veut faire, si on veut appartenir à, si on veut avoir des relations avec les autres, il faut parler, échanger – ou se taire – mais enfin il faut s’inscrire dans un de ces quatre discours. Si on n’y parvient pas, on a de sérieux ennuis. Il y a des êtres humains qui parlent, qui écrivent, mais qui n’arrivent pas à s’inscrire dans un de ces discours. C’est le cas des psychotiques. »
Double Aliénation (Oury) :
Relations entre le politique et l’analytique, ce que J. Oury théorisera en termes de double aliénation : aliénation transcendantale ou psychopathologique, et aliénation sociale au sens marxiste.
Émotion :
In Affect, éprouvé, émotion, sentiment : notations terminologiques – RFP 1999/1 p.11 –
« (…) l’émotion, contrairement à l’affect, apparaît comme un mouvement du sujet dont la source essentielle est un événement du monde extérieur et non une représentation qui émane de son monde intérieur. La source externe de l’émotion est liée au hic et nunc de la relation ».
(…) ce qui fait la différence entre émotion et affect tient à la qualité du contenu représentationnel associable à l’un et à l’autre de ces deux types d’éprouvés : tandis que le contenu représentationnel associable à une émotion est toujours directement et exclusivement en relation avec la situation d’actualité, qu’il est en somme encapsulé dans le hic et le nunc, la représentation associable à l’affect suppose un « décroché » de la situation d’actualité (la scène où se situe l’échange, celle où se tient le sujet). »
Éthique :
Buzaré A. – J. Lacan nous dit : l’éthique est à l’articulation de mon désir et de l’action que je mène.
J. Oury -Séminaire « Le Collectif » – P80 – « l’éthique, c’est, dit Lacan, l’articulation entre son désir et sa propre action.
Oury -Séminaire « le collectif » – P38 – paraphrasant Lacan : dans son séminaire de 59-60 sur l’éthique, il définit ce qu’il en est de l’éthique dans le champ de la psychanalyse : une mesure qu’il y a dans l’action entre l’action et son propre désir. La validité de ton action, au sens éthique du terme, c’est en quoi elle se rapporte à ton désir. (…) désir n’est pas plaisir, jouissance, il faut bien distinguer les choses.
Établissement / Institutionnalisation :
Oury – Le Collectif P161 – l’établissement, c’est ce qui est mis en place par l’État, c’est quelque chose qui « établit » un contrat avec l’État, qui est donc délégué par l’État pour organiser un certain travail. Alors, la première démarche de la psychothérapie institutionnelle, c’est de mettre en question cette problématique. Est-ce qu’il est possible que l’État puisse efficacement déléguer…un établissement, pour organiser un champ de travail psychothérapique ?
Fantasme :
G. Bulat-Manetti, In. La clinique lacanienne n°17 p. 64 – « le rôle du fantasme est d’assurer la possibilité de la subjectivation de la jouissance, de la projeter à l’avenir. Le fantasme pose entre le réel et le symbolique un imaginaire, qui sert d’amortisseur entre le réel et la réalité qu’il crée. »
Forclusion, forclore la représentation :
Nasio, p49 : « Cela veut dire qu’une représentation psychique, déjà trop surinvestie par le moi, se voit soudain privée de toute signification. L’expulsion (métaphore spatiale) équivaut à un retrait brutal de signification (métaphore économique)
(…) le Moi est troué dans sa substance ; et au trou dans le moi correspond un trou dans la réalité.
La représentation psychique rejetée est la copie psychique de la réalité. Si il y a un rejet massif de cette représentation psychique, il y a abolition de la réalité.
Forclusion locale :
Nasio p52 : « A la place d’une réalité symbolique abolie, apparait une nouvelle réalité compacte hallucinée qui coexiste chez le même sujet, avec d’autres réalités psychique non touchées par la forclusion.
(…) tout comme le sujet halluciné, l’analysant névrosé entend la voix de son inconscient, mais le vécu est radicalement différent. Alors que le névrosé, étonné, admet que son inconscient parle à travers lui et qu’il en est l’agent involontaire, le psychotique, frappé de certitude, a la douloureuse et inébranlable conviction d’être la victime d’une voix tyrannique qui l’aliène. »
Hallucination :
J. Oury (« à quelle heure passe le train ») – les voix sont au plus près du réel, elles ne sont pas dans le réel. Comment pourrait-on faire réapparaitre dans le réel quelque chose qui ne s’est pas inscrit ? Les hallucinations, c’est un bricolage pour remplacer l’usage déficient des mots, un bricolage qui s’interpose comme il le peut, entre un psychotique et le réel. Il y a une déficience, chez un psychotique, de ce que Freud appelle le système de « pare-excitation », qui est un système de défense.
Hiérarchie :
Oury – « Le collectif » P115 – « la dépendance, c’est ce qui est entretenu par les structures hiérarchiques. (…)
Hiérarchisation absolue :
Oury J. -Hiérarchie et sous jacence (séminaire)- 2014 p,165 – « que faut-il pour qu’il y ait des événements, pour que quelque chose puisse s’inscrire ? La question à 100 balles. Il faut entretenir le lien pour qu’il y ait constamment une distinctivité (…) c’est à dire qu’il faut qu’il y ait (…) de l’hétérogène (…). Je suis pour la hiérarchisation, absolue, presque, c’est à dire pour que chaque personne qui travaille dans tel lieu, quand on la voit, on ne la mélange pas avec une autre. Autrement dit, que chaque personne soit dans sa singularité ».
Honte :
(Milan Kundera)- La honte n’a pas pour fondement une faute que nous aurions commise, mais l’humiliation que nous éprouvons à être ce que nous sommes sans l’avoir choisi, et la sensation insupportable que cette humiliation est visible de partout.
Hystérie :
Nasio – l’hystérique, comme tout sujet névrosé, est celui qui, à son insu, impose dans le lien affectif à l’autre la logique malade de son fantasme inconscient. Un fantasme dans lequel il joue le rôle d’une victime malheureuse et constamment insatisfaite. Cet état fantasmatique d’insatisfaction marque et domine toute la vie du névrosé.
Chez hystérique, (…) pour s’assurer de l’état d’insatisfaction, l’hystérique cherche dans l’autre la puissance qui le soumet ou l’impuissance qui l’attire et le déçoit.
L. ISRAEL (Hyst. Sexe et Médecin) – les amnésies hystériques sont repérées dans le discours par un « je ne sais pas », précieux indice diagnostic. De façon humoristique, on peut illustrer cette « lacune mnésique » par une phrase fréquemment prêtée à l’hystérie : « il m’a emmenée dans sa chambre, m’a couchée sur son lit, et après je ne sais pas ce qui a pu se passer ». l’oubli ne porte pas sur n’importe quel événement.
Hypomanie
Élévation légère, mais persistante, de l’humeur, de l’énergie et de l’activité, associée habituellement à un sentiment intense de bien-être et d’efficacité physique et psychique. Il existe souvent une augmentation de la sociabilité, du désir de parler, de la familiarité, ou de l’énergie sexuelle et une réduction du besoin de sommeil ; ces symptômes ne sont toutefois pas assez marqués pour entraver le fonctionnement professionnel ou pour entraîner un rejet social. L’euphorie et la sociabilité sont parfois remplacées par une irritabilité ou des attitudes vaniteuses ou grossières. Les perturbations de l’humeur ou du comportement ne sont pas accompagnées d’hallucinations ou d’idées délirantes.
Idéalisation :
« Santé Mentale » n°97 : Idéaliser des objets extérieurs qui deviennent parfaits et ne sauraient souffrir de la moindre imperfection. Objets idéalisés vont servir de supports identificatoires narcissiquement gratifiants.
Idéal du Moi :
« Santé Mentale n°97 » : Du point de vue topique, l’idéal du Moi est pôle organisateur de la personnalité. Chez état-limite, il occupe une place dévolue normalement au Surmoi, et reste puéril et gigantesque. La vie relationnelle est ainsi abordée avec des ambitions héroïque, démesurées, exclusives qui préjugent mal de leur réussite confrontée aux exigences de la réalité.
Identification projective :
Oury « Le Transfert », psychothérapie institutionnelle n°8&9 1991 – « l’identification projective est de l’ordre de la possession. (..) il y a une sorte de projection de l’autre à l’intérieur de vous-même, pour vous vider complètement. C’est comme quand on mange du homard ou une langouste : on vide tout ça, on bouffe tout l’intérieur, il n’y a plus que la coquille. (…) toute puissance d’annihiler l’autre ; c’est très archaïque comme système , une sorte de cannibalisme. On sort de là complètement éreinté ! ça c’est l’identification projective.
(…) il y a une sorte de mouvement identificatoire qui confine à la confusion des corps, mais ce mouvement même est une sorte de mouvement de transfert, parce que c’est la seule façon, pour le sujet, de se manifester, de communiquer quelque chose à l’autre.
Cette opération partielle et omnipotente, on la décrit également (Bion) sur des objets. Ce n’est donc pas seulement se projeter sur l’autre pour le bouffer.
V. Di Rocco Revue Santé Mentale 230 p.45 – « l’identification projective est une notion assez proche du concept de projection utilisé par S. FREUD. Toutefois, i l s’agit ici d’un mécanisme de défense précoce rendu nécessaires par les angoisses primitives du nourrisson. Ce mécanisme renvoie vers l’extérieur -sur l’objet primaire – , les angoisses destructrices vécues par l’enfant. Dans cette logique, le thérapeute n’est plus seulement l’écran qui permet de donner forme aux scénarios projetés parle patient dans le cadre de la relation transférentielle, il devient le contenant des parties clivées impensables et vécues comme terriblement angoissantes par son patient. Il est alors le lieu de dépôt de ce qui est vécu comme potentiellement destructeur par le sujet. »
Inconscient :
M. Neyraut – Le transfert p.24 – « la suspension (suspension de la réponse dans la situation analytique), ressentie comme l’attente d’une interprétation, (est) nécessaire pour déjouer l’essence même du déguisement de l’inconscient, c’est dire d’une autre façon que ce déguisement, ce déplacement ou cette condensation des éléments figurables de l’inconscient, n’est si bien déguisée que de s’adresser à quelqu’un d’autre qui l’entend et lui répond. (…)
Interstice (temps interstitiels) :
P. Delion (Psychose vie quotidienne) – (…) sont les moments entre 2 activités thérapeutiques. Temps est fondamental : c’est à ce moment que les enfants ou adultes fabriquent dans leur appareil psychique des représentations de ce qu’ils viennent de faire juste avant et anticipent ce qu’ils vont faire juste après. Ainsi, ils éprouvent la solidité de leur système représentatif et leur capacité à garder ou non en eux ce q’ils viennent de faire avec les soignants.
Institution :
Enriquez – « une institution (…) a pour rôle (…) la régulation sociale puisqu’elle a pour but de maintenir un état (…) de faire durer et de favoriser la transmission et la socialisation de ses membres.
Ginette Michaud : – « L’institution est une structure élaborée par la collectivité tendant à maintenir son existence en assurant le fonctionnement d’un échange social de quelque nature qu’il soit » un chainon entre le sujet et le corps social.
P. Coupechoux – C’est toujours le patient qui, en dernier ressort et sans le savoir, décide de ce que sera la nature de l’instituion, parce que, poursuit H. Chaigneau, « la vie dépasse le cadre ». Cette coproduction –entre l’équipe et le patient-nécessité que l’on se mette au rythme de ce dernier. (…) l’institution que l’on va créer avec lui joue le rôle d’un « objet transitionnel » entre lui et les autres (..) qui soit suffisamment souple pour s’adapter aux difficultés relationnelles du malade, mais aussi capable de lui fournir un point d’appui solide et pérenne. Ginette Michaud : « c’est précisément pour régler cet échange entre la demande (…) du sujet et la réponse que lui apporte le groupe que va se placer l’institution ».
Incorporation :
Laplanche et Pontalis (Vocabulaire de psychanalyse) – « processus par lequel le sujet sur un mode plus ou moins fantasmatique fait pénétrer et garde un objet à l’intérieur de son corps. L’incorporation constitue un but pulsionnel et un mode de relation d’objet caractéristique du stade oral. (…) elle constitue le prototype corporel de l’introjection et de l’identification.»
Jouissance :
Pierre Marie In Topique « La Jouissance » : « (…) très tôt, dès le 5 octobre 1895, Freud souligne que l’expérience de satisfaction ne repose pas tant sur la disponibilité d’un objet que sur « l’attention d’une personne secourable (qui est ordinairement l’objet désiré, das Wunschobjekt)». Ce n’est pas l’objet qui importe, c’est la « personne » susceptible de l’apporter qui a ainsi le statut d’objet désiré. (…)Quoi que nous en pensions, ce n’est pas tant l’objet de la pulsion qui compte, friandises, petite madeleine amollie dans le thé, que, comme l’indique Lacan, la demande de la « personne secourable » sous les traits du « signifiant » qui la représente et dont l’objet n’est que le référent. (…) La pulsion ne se satisfait pas tant d’un objet que du « signifiant » de la demande de l’Autre, précision que corroborent les propositions de Wittgenstein et Quine : nous n’avons pas d’accès direct à l’objet, il nous est donné par le langage. La pulsion se satisfait des mots de l’Autre. (…)Le plaisir est ainsi un principe toujours déjà corrodé par l’impossibilité de sa réalisation et l’obligation de sa répétition, et s’il est toujours déjà jouissance, c’est qu’il prend ses conditions non auprès d’un objet, l’objet précise Freud est indifférent, mais auprès des « signifiants » de la demande de l’Autre (…)La visée de la pulsion n’est donc pas le plaisir, mais la jouissance, si l’on veut bien entendre par ce terme la modalité propre à chacun d’exister, si exsister, c’est se situer au regard de l’Autre. (…)C’est en 1905, que Freud explicite en quelque sorte le ressort de la scène la plus ancienne du cas Emma : l’expérience de satisfaction, Befriedigungserlebnis, suppose non seulement la présence d’une « personne secourable », mais l’attente par cette « personne » d’un bénéfice de sa fonction.
Braunstein, Néstor A. La jouissance. Un concept lacanien. Érès, 2005- La plus courante fait de la jouissance un synonyme du plaisir. La psychanalyse les oppose, en faisant de la jouissance soit un excès intolérable de plaisir, soit une manifestation du corps plus proche de la tension extrême, de la douleur et de la souffrance. Il faut choisir : c’est ou l’un ou l’autre1
Mélancolie :
Freud (Deuil & Mélancolie) :
Mélancolie = se caractérise du point de vue psychique par une dépression profondément douloureuse, suspension de l’intérêt pour monde extérieur, perte capacité d’aimer, inhibition de toute activité et diminution du sentiment l’estime de soi (auto-reproches, va jusqu’à l’attente délirante de châtiment).
Mélancolie peut être elle aussi réaction face à perte d’objet, physique ou morale. Inhibition mélancolique nous semble une énigme, en cela que nous ne pouvons pas voir ce qui absorbe si complètement les malades. Le mélancolique présente encore aussi une diminution extraordinaire de son sentiment d’estime de soi, immense appauvrissement du moi, chose absente chez endeuillé. Le moi est devenu pauvre et vide, dans deuil, c’est le monde extérieur.
Dans mélancolie, l’objet est perdu, mais « le sujet ne sait pas ce qu’il a perdu », car la perte, à la différence du deuil, est inconsciente, et le mélancolique ne peut faire aucun travail de deuil. Mélancolique a subit une perte concernant son moi, pas une perte concernant l’objet comme lui le dit.
Instance critique (la conscience morale) est séparée du moi → clivage → un moi s’oppose à l’autre.
Plainte du mélancolique est une plainte portée contre → toutes les paroles dépréciatives prononcées à leur égard sont au fond, prononcées à l’encontre d’un autre.
Hypothèse de l’étiologie du trouble :
Il existait d’abord un choix d’objet, une liaison de la libido à une personne déterminée ; sous l’influence d’un préjudice réel ou d’une déception de la part de la personne aimée, cette relation fut ébranlée. Le résultat ne fut pas celui attendu, à savoir retrait de la libido de cet objet et déplacement sur un autre. Libido ne sera en fait pas déplacer sur un autre, mais retirée dans le moi. Elle servit alors à établir une identification du moi avec l’objet abandonné. L’ombre de l’objet tomba alors sur le moi identifié par l’instance psychique comme un objet, comme l’objet abandonné. De cette façon la perte de l’objet s’était transformée en une perte du moi et le conflit entre moi et personne aimée en une scission entre la critique du moi et le moi modifié par identification.
Analyse de la mélancolie nous enseigne que le moi ne peut se tuer que lorsqu’il peut, de part le retour de l’investissement de l’objet, se traiter lui-même comme objet, lorsqu’il peut diriger contre lui-même l’hostilité qui vise un objet et qui représente la réaction originaire du moi contre des objets du monde extérieur.
Tonalité maniaque de la mélancolie : Tendance à se renverser dans l’état dont les symptômes sont opposés, la manie. Alternance régulière de phases mélancoliques et maniaques → folie cyclique.
Dans la mélancolie se nouent autour de l’objet une multitude de combats singulier dans lesquels haine et amour luttent l’un contre l’autre, la haine pour détacher la libido de l’objet, l’amour pour maintenir cette position de la libido de l’objet contre l’assaut. Combats sont en lieu et place dans inconscient.
Mélancolique (Discours) :
Lambotte « Santé Mentale », n°147 : « Accompagne une symptomatologie apparemment similaire à celle du patient dépressif. Le sujet mélancolique inverserait dès la 1ère rencontre le type de relation : il se placerait lui-même du côté du supposé savoir ; en face d’un thérapeute dont il tente d’invalider la pratique.
Réduire l’autre à l’impuissance dès lors qu’il pourrait en recevoir quelque chose : cette position peut indiquer une réelle déception qui a du dans un temps originaire, relever d’un véritable traumatisme.
« Il avait existé un choix d’objet, une liaison de la libido à une personne déterminée. Le sujet se comporte comme si, de toute façon, la déception devait être nécessaire.
Le partage du temps chez le mélancolique marque la différence avec la dépression (= figure d’un « avant et d’un après ») ; le temps, suspendu, propre au mélancolique, un temps sans commencement ni fin. »
L’objet qui manque dans la mélancolie :
Lambotte : « cet objet voilé, masqué, obscur, celui là même qui a manqué au sujet mélancolique et à la trace duquel ce dernier s’identifie, au point d’en épouser le mouvement d’évanouissement dans une tendance à l’autodestruction. Lacan insiste sur une différence métapsychique entre dépression et mélancolie : chez le dépressif, il peut s’agir (objet) d’une bonne/mauvaise image, et surtout à la perte d’un objet accompagné du travail de deuil.
Narcissisme primaire :
Narc. Primaire et expérience du manque – « à un moment ou à un autre, un besoin surviendra en son absence. Le petit enfant fait face à cette situation au moyen de la satisfaction hallucinatoire. (…) inaugure une distinction entre la source, le ressenti interne de l’excitation et l’origine externe de la satisfaction réelle.
(…) le bébé a maintenant des images internes des représentations de l’objet satisfaisant dont il peut se servir : il constitue son objet interne.
Névrosé :
M. Neyraut – le transfert p.32- « les névrosés vivent dans un monde particulier où seules ont causes les valeurs névrotiques. C’est-à-dire que les névrosés n’attribuent de l’efficacité qu’à ce qui est intensément pensé, affectivement représenté, sans se préoccuper de savoir si ce qui est pensé et représenté s’accorde ou non avec la réalité extérieure. »
Parole :
Roudinesco, Élisabeth. « Lacan, la parole », Revue de la BNF, vol. 47, no. 2, 2014, pp. 38-44-
« Dans la cure analytique, la parole permet au patient de se déprendre de la séduction, alors que dans la captation liée au pouvoir ou à l’enseignement, elle sert à aliéner les sujets. »
Pathologique :
Lantéri-Laura (2005) – le pathologique n’est jamais unitaire et il existe toujours plus d’une manière d’être malade ou d’être blessé.
Personnalité :
Sullivan H.S. – Une personnalité ne peut jamais être isolée du complexe de relations interhumaines qui ‘entourent »
Perversion :
Sibony, par Liaudet (Us et abus de la névrose libérale dans les institutions) – « la perversion est un traumatisme assumé » (…) « ils vont passer l’intervenant à la question : ils aimeraient tant trouver une voix qui ne mente pas ! (…) l’intervenant ne tient pas le coup, car aucune autorité ne doit tenir. »
Legraverand A. (JDP321) : « (…) le comportement pervers ne serait pas la signature d’une structure de personnalité particulière, mais plutôt une défense projective contre l’anxiété, permettant au sujet de venir renverser le vécu d’emprise et d’intrusion. (…) Le (sujet) pervers est dans le défi permanent et cherche constamment à détrôner ceux qu’ils jugent comme les puissants (cit. A. Eiguer). »
Legraverand A.(JDP321) – « pour le pervers, la jouissance vient faire Loi, en lieu et place de la Loi elle-même. »
Lire Vladimir Nabokov – il tente de faire de l’inacceptable quelque chose d’acceptable ; il nous fait nous questionner sur ce qu’il est normal ou non d’accepter.
« le sujet pervers fonce vers le danger et les risques, obligeant la loi à intervenir comme seul frein possible ».
C. Mazel (Santé Mentale 47) – « Dans la névrose et la perversion, il y a accès à la castration symbolique avec des possibilités d’angoisse, de culpabilité et de refoulement. (…) dans la perversion, l’accès à la jouissance se déploie de façon ordonnée et a pour but de déplacer la culpabilité et l’angoisse sur la victime. (…) c’est la victime qui devient le lieu de déplacement de la castration symbolique. »
(…) dans les transgressions, le pervers est du côté de la névrose avec des possibilités d’accès au symbolique. »
Perversion sexuelle :
Legraverand A.(JDP321) – « s’il n’y a pas nécessairement de perversion sexuelle chez le sujet pervers, la perversion sexuelle existe en tant que structure à part entière et peut s’annexer à d’autres fonctionnements psychiques. Elle est dite de « but » ou « d’objet ».
On parle de perversion sexuelle dès lors que la sexualité est le fait d’un comportement compulsif et répétitif, que ces comportements sont essentiels pour parvenir à la jouissance et que toute la sexualité s’organise autour de ces comportements.
Pervers narcissique :
Legraverand A.(JDP321) – « le «pervers narcissique » manipule l’autre dans le but de réduire sa victime au statut d’objet de jouissance (…) à une entité dénuée de désir propre. (..)
Il est d’ailleurs parfois étonnant d’observer la victime des sujets pervers narcissiques. Ce sont svt des personnalités fortes, le pervers relevant le défi d’anéantir un autre, solide. La victime vulnérable n’ayant que peu d’intérêt pour le sujet pervers, au contraire du paranoïaque qui cherchera une victime peu menaçante, permettant de ne pas mettre à mal ses défenses narcissiques (cit. Barus-Michel).
Psychiatre :
C. Sahli et al. « Psychiatre et psychothérapie Quid ? » – Le psychiatre (peut alors) poser des hypothèses diagnostiques sous forme par exemple d’un diagnostic différentiel hiérarchisé. Ceci lui permet d’orienter l’élaboration d’un plan de traitement (..)
Psychiatrie :
Jovelet (Les conditions de la psychiatrie publique) – Discipline dont le champ recoupe psychologie, psychopathologie, la sociologie, la psychanalyse, l’anthropologie, la criminologie, et dont l’exercice est articulé avec la médecine, le social, la justice ; Toute la dimension médico-sociale qui signe notre implication vis-à-vis des formes modernes du malaise social, précarité, exclusion, toxicomanie, comportements déviants, extension de la « dépression », et diverses inadaptations comme la souffrance au travail.
Psychopathie :
C. Mazel (Santé Mentale 47 p.26) – dans la structure psychopathique, les passages à l’acte brutaux et apparemment immotivés sont un moyen de jouissance sans passer par la frustration comme elle existe dans la névrose. Il n’y a pas de culpabilité ni de transfert de celle-ci sur la victime comme dans la perversion. On peut formuler l’hypothèse que la psychopathie et les conduites antisociales protègent en fait le sujet de l’effondrement psychotique. Mais là, le sujet se fait prendre et se retrouve souvent en prison ou hospitalisé, où il rencontre la Loi dans le réel. »
« (…) (Le symbolique) est absent dans la psychopathie, qui est du côté de la psychose, sans accès au symbolique mais seulement au réel et à l’imaginaire, sans possibilité de construire un phantasme et de le refouler. »
Santé Mentale n°47, p.26 :
A l’âge adulte, le psychopathe se distingue par son côté « touche à tout », mais l’ojn assiste à une succession d’essais et d’échecs, sans insertion professionnelle correcte. Il en résulte un parcours professionnel et sentimental chaotique.
(…) le goût du risque et de la nouveauté ainsi que son incapacité à différer une satisfaction conduisent le psychopathe à des actes de délinquance traduisant son besoin de satisfaction immédiate.
La personnalité :
- Impulsivité et agressivité : résoudre tout conflit par le passage à l’acte. Sans anticiper les conséquences et répond ainsi à la satisfaction d’un désir immédiat qu’il lui est insoutenable à reporter.
- Inaffectivité : égocentrique, il méprise autrui, qui n’a d’utilité que s’il peut en profiter ; cela aboutit à la négation de l’autre ou à une instabilité des liens affectifs et sociaux.
- Instabilité thymo-affective : on peut assister à épisodes d’hyperémotivité avec angoisse, perte du contrôle émotionnel.
- Passage à l’acte facilité : il s’inscrit le plus souvent dans un contexte de frustration pouvant provoquer des blessures ou des TS graves.
- Le parasitisme : va vivre, agir au dépens d’autrui ou de la société ; le psychopathe avec l’âge peut vivre dans un monde marginalisé.
Peut y avoir un certain théâtralisme désespéré ; ennui.
« ces diverses facettes ont fait qualifier le psychopathe « d’arlequin ou de caméléon de la psychiatrie », plusieurs attitudes se succédant au cours de la même journée.
Psychosomatique :
Danis (Santé Mentale 209, 2016) – dans le psychosomatique, le corps somatique est atteint (somatisation). Pour Roussillon, (2014), « le corps serait en attente de sens (…) » un impensable psychique.
L. ISRAEL (Hyst, Sexe et Médecin) – (…) s’agit toujours de troubles exprimant soit des lésions anatomiques (tous les ulcères, par ex) soit des perturbations biologiques comme certaines formes d’hypertension artérielle.
Le sujet souffrant de maladie psychosomatique peut être tout à fait exempt de troubles névrotiques ; du moins de troubles suffisamment graves pour qu’il en souffre avant que l’entourage les remarque.
Psychothérapie Institutionnelle :
Buzaré A. – Accueillir la demande sans y répondre, ou du moins jamais de manière fermée (…) c’est ainsi que la place se fait au Désir, dans toute la singularité de chacun (…) la réponse est à chercher ensemble (…) cette recherche crée une mise en mouvement des uns et des autres (…) la Psychothérapie Institutionnelle c’est un mouvement, ça bouge, ça cherche, ça parle, ça dit des conneries, ça échange, ça vit !
La Psychothérapie Institutionnelle c’est se préoccuper en même temps de l’individuel et du groupal (…) de la double aliénation à laquelle aucun être humain n’échappe. (…) Il faut tenir compte, s’occuper de l’autiste et du désert !
La Psychothérapie Institutionnelle marche sur deux jambes : psychanalytique (décentrer vers l’inconscient le centre de gravité de toute vis psychique) // marxiste (montrer comment l’homme pouvait être aliéné socialement du fait de processus éco-politique).
P. Coupechoux– « il y a dans la psychothérapie institutionnelle une revendication de précarité, de provisoire, (…) F. Tosquelles aimait à dire que la psychothérapie institutionnelle « ça n’existe pas », et que seule est valable « l’analyse institutionnelle ».
Projet de soin (Psychiatrie) :
Le pds est-il un projet normatif de disparition des troubles ou d’un aménagement des symptômes, dans une visée de pacification, c’est à dire de mieux vivre avec les autres tout en étant un sujet autiste, psychotique ou présentant des altérations cognitives et sans avoir à renier sa différence ? Comment concilier soins, normalité médicale, sociale et sécurité ? Faut-il être interventionniste et intrusif vis-à-vis d’un sujet délirant ou ménager des espaces de libertés en particulier au sein de structures de soins comme CMP, HDJ, pour vivre sa folie ?
La psychiatrie, comme la société est intolérante au fait mental, les services de psychiatrie constituent moins un espace-temps de répit pour exprimer sa folie dans un lieu dédié. Il est exigé une normalisation prompte du comportement, pour l’obtention d’une sortie rapide.
Quelle place occupe dans la gestion d’un hôpital aujourd’hui le désir de soigner, le désir du soignant ?
Psychose :
Nasio, p49 : « 3 temps dans processus psychotique :
- Surinvestissement par le moi d’une représentation psychique qu’il hypertrophie et ainsi rend incompatibles avec autres représentations normalement investies.
- Rejet violent et massif de la représentation ; abolition réalité qui y est liée
- Perception par le moi du morceau rejeté sous forme d’une hallucination ou d’un délire.
Selon le point de vue économique : surinvestissement/retrait violent/déni complet réalité correspondante/substitution réalité perdue.
Oury – A quelle heure passe le train ? – les psychiatres (…) ont affaire avec des êtres qui essaient de se construire eux mêmes, en délirant, en faisant des sculptures bizarres, ou en cassant des carreaux, et qui n’en n’ont jamais fins avec ce travail. Des héros qu’il faut qu’ils soulèvent le rideau de la scène tous les jours.
Psychologie clinique :
In cours P. Lambert – « L’objectif de la psychologie clinique, c’est de ne pas éloigner le sujet de sa culpabilité ».
Qu’est-ce que je fous là ?:
J. Oury -Séminaire le Collectif – p 80 – « (…) l’un des axiomes de la psychothérapie institutionnelle : « qu’est-ce qu’on fout là ? » (…) on sait bien que dans une analyse, chaque séance recommence à zéro ; il n’y a pas d’hystérésis ; il n’y a pas cette sorte de nébuleuse qui continue et imprègne l’histoire. Et quand il s’agit d’estimer ce qui peut se présenter sur un mode collectif, c’est la même procédure. (…) ce qui est posé là n’est pas jaugeable au niveau du grade officiel de chacun. C’est quelque chose de l’ordre de « l’idéal du moi » mais également de la dimension sublimatoire. Dans le travail d’analyse générale auquel on participe, il est essentiel de savoir à quelle place on se trouve, autrement dit, à quel niveau on est soi même, non pas en tant que personne, ni en tant que sujet, mais en tant que représentant d’un certain désir. C’est ça qui est en question dans l’action même, dans les actes de tous les jours. Et le désir est à distinguer de tout ce que vous pouvez imaginer : la demande, le besoin, la jouissance. (…) la question que je pose « qu’est-ce qu’on fout là ? », en fin de compte revient à : « qu’en est-il de mon désir d’être là ? ».
Oury – A quelle heure passe le train ? – « qu’est-ce que e fous là ? » c’est une façon de s’exposer au possible, une sorte de réduction phénoménologique (…) on pourrait aussi bien dire : une réduction de type schizophrénique. Quand on pense qu’un schizophrène a perdu tout rapport avec les évidences, ce que Erwin Straus appelle les axiomes de la quotidienneté, qui font qu’on enfile une veste plutôt par les bras, et un pantalon de préférence par les jambes, qu’il n’a pas de rapport à son histoire, donc pas avec son avenir, cette réduction à minima, pas très confortable, est un préalable pour envisager la rencontre avec lui qui te demande, comme si il se le demande à lui-même, ce que tu fous là. »
Refoulement :
3 échecs de refoulement dans la névrose :
- Echec par déplacement (de la surcharge d’une représentation à une idée : névrose obsessionnelle)
- Echec par projection (surcharge de l’intérieur psychique sur le monde extérieur : phobique)
- Echec par conversion (de la surcharge en symptôme somatique : hystérie)
Freud (Métapsychologie) :
Destin possible pour une motion pulsionnelle → se heurter à des résistances cherchant à la rendre inefficace → elle arrive alors en situation de refoulement.
Refoulement originaire : une première phase du refoulement, qui consiste en ceci que le représentant psychique (représentant – représentation) de la pulsion se voit refuser la prise en charge dans le conscient. Avec lui se produit une fixation : pulsion demeure liée au représentant correspondant
Le refoulement proprement dit : deuxième phase du refoulement qui concerne les rejetons psychiques du représentant refoulé, ou bien telles chaînes de pensées qui, venant d’ailleurs, se trouvent être entrées en relation associatives avec lui. Du fait de cette relation, ces représentations vont connaître le même destin que le refoulé originaire.
! Le refoulement n’empêche pas le représentant de la pulsion de persister dans l’inconscient, de continuer à s’organiser, d’établir des liaisons. Le refoulement ne trouble en fait que la relation a un système psychique, celui du conscient.
Rencontre :
Buzaré A – Nous éprouvons là où nous sommes déjà nous-mêmes éprouvés. H. Maldiney dit : en quoi suis impliqué dans une rencontre ? me voici en présence d’un autre, un autre qui se présente en tant qu’un autre, c’est à dire tel que je ne peux pas l’inventer. Si je peux l’inventer, il se dissout. Et qu’est ce que je ne peux pas inventer ? Au sens propre, un visage qui n’est pas une image. Le regard.
Répétition :
Oury – A quelle heure passe le train – // à Lacan – « la répétition c’est toujours nouveau. Parce que ça allait se faire, ça allait s’inscrire, et puis ça a manqué, la rencontre avec le réel, on nous a appelés pour la soupe. Alors on essaie à nouveau ».
Rêve & Pensée :
M. Neyraut –le trasfert- « pendant que le rêve trouve le chemin le plus direct de la satisfaction hallucinée, la pensée cherche par des moyens détournés les même satisfactions, mais recrute en cours de route tous les éléments qui concourent à la résistance comme aussi bien ceux qui servent à l’élucidation du sens.
Sadisme :
Legraverand A.(JDP321) – « le sadisme ne devient perversion que si la violence est la condition pour atteindre la jouissance. »
Legraverand A.(JDP321) – « selon Freud, le sadisme, comme le masochisme impliquent une notion d’érotisation, un investissement libidinal(…) le sadisme se constitue d’une pulsion d’emprise, comme dans la perversion, qui implique la recherche d’une victoire narcissique, à des fins défensives du Moi, sur un objet narcissiquement représenté. (…) comme dans la cruauté, l’attaque de l’autre n’a pas pour seul but de faire souffrir, mais aussi de se défendre contre une menace inconsciente.
« Le sadisme est une violence qui rejette rageusement tout ce qui vient de l’extérieur. »
« Le sadique sexualise la douleur qu’il inflige, mais aussi de la perception que se fait la victime du sadique qui veut la faire souffrir (R. Roussillon, 2002) : la peur dans ses yeux me suffit ». le sadique aurait été humilié dans son statu et sa place (Jeammet,2002) ; il réduit alors sa victime à un double de lui-même sur lequel il peut externaliser ses souffrances.
Schizophrénie :
Tosquelles ou Oury- « qu’est-ce qu’un malade schizophrène ? » – « C’est quelqu’un qui a perdu 3 choses. Comme dans la tragédie racinienne, l’unité d’action, l’unité de temps, l’unité de lieu. Imaginez une personne qui ne sait plus où il est ; qui ne peux pas franchir une limite d’espace sans avoir une terreur moyenâgeuse (sortir des ports, expédition) ; (…) il ne connaît pas non plus la notion du temps. Il ne s’est pas constitué une histoire racontable (roman). Il a perdu ces 3 dimensions.
Quand un schizophrène vous parle, et que quelqu’un d’autre arrive dans la discussion, il ne se rend pas compte qu’il y a un triangle. Il peut parler à ces 2 personnes à la fois. Il ne peut pas imaginer qu’il y ait un autre qui rentre en discussion.
Oury – « quand on rencontre un schizophrène, on se confronte à l’incapacité de le recentrer en un point. Point de recentrement chez Lopez Ibor. (…) quand un normopathe arrive, qu’il soit obsessionnel, hystérique, etc. plus ou moins dépersonnalisé on n’est pas « surpris ». Toute sa personnalité se rassemble en un point.
Self (soi limite) :
Materson : « L’enfant développe un faux soi défensif qui s’accommode aux besoins émotionnels du parent aux dépens de l’expansion de la croissance et de l’expression du soi réel. (pour palier à la dépression d’abandon ?).
Semblant :
Oury J. – Séminaire « Le collectif » P66 – « ce qu’il y a de plus fragile, c’est ce qui fait « l’ambiance », en fin de compte : c’est une certaine qualité du semblant. On voit bien que sur ce qui se passe dans un tissu social, de vie quotidienne -façon de saluer quelqu’un – que tout ça peut être complètement cassé ; et que cette destruction là elle ne touche pas le niveau du réel, ni le niveau du symbolique, ni celui de l’imaginaire : ces systèmes là n’appartiennent pas à la sous-jacence, mais ils sont le soubassement de ce qui est en question. Le tissu même de l’existence, ce qui fait qu’on peut saisir quelque chose rapidement, et que ça va engager un autre niveau de pensée, il faut bien l’appeler par un mot. On peut dire que ce qui va faire agir, ce qui va faire qu’il y a quelque chose qui bouge, qu’on va pouvoir passer à autre chose que ce qu’on était en train de penser, il me semble qu’on peut, en première ligne, appeler ça le semblant.
Sens, signification :
Oury – Le collectif p155 – le sens, c’est le détour, la signification, c’est la ligne directe. (…) la signification c’est bien cerclé, bien défini, bien déterminé, alors que le sens, ça n’en finit jamais.
Statut, rôle, fonction :
Oury – Le collectif P114 – « au départ de la psychothérapie institutionnelle, je disais qu’il fallait faire des exercices : bien distinguer les rôles, les statuts, les fonctions. Le statut de médecin, c’est un « statut de médecin » qui est inscrit, comme ça, dans l’Etat ; mais la fonction médicale, surtout sur le plan psychiatrique, on sait bien que c’est une fonction extraordinairement variée, qui se ventile à des quantités de niveaux, et qui peut être représenter par des personnes, des espaces, des tas de trucs. Si le médecin-chef disait : « je suis la fonction médicale », il parlerait comme un paranoïaque. »
Symptôme :
In cours Licence 1 – à différencier de « signes » cliniques (= tout ce qui concerne manifestations objectives, perceptibles d’un état pathologique). La notion de symptôme réfère à la plainte subjective du patient. Pour Freud, le symptôme apparait comme une traduction d’un conflit psychique inconscient, et aura pour conséquences une désadaptation + ou – importante.
Subjectivité – Intersubjectivité :
Golse, B. (2014). De l’intersubjectivité à la subjectivation: Un exemple de passage de l’interpersonnel à l’intrapsychique. Enfances & Psy, 62, 29-38 – « L’intersubjectivité permet la découverte de l’autre dans le registre interpersonnel, tandis que la subjectivation permet, dans le registre intrapsychique, de se découvrir soi-même comme un sujet mais aussi de découvrir l’autre comme un objet qui est lui-même, de son côté, un sujet, soit de le découvrir comme un « objet-autre-sujet » (Golse, Roussillon, 2010) »
Transfert :
M. Neyraut –le transfert – « (le transfert) point de fuite au sens du dessin de perspective : l’image de l’analyste s’y profile ou s’y estompe comme en un trompe l’œil. »
Oury « Le transfert » -Revue de Psychothérapie Institutionnelle, n°8 &9 1991 p.25 – (…) de façon un peu restreinte, mais rigoureuse, on pourrait définir le transfert comme condition de possibilité de l’émergence d’un dire. C’est souvent dans le silence qu’il y a du « dire » ; et quand il y a un espace du dire, ça se sent.+
P. Coupechoux – « Le patient éprouve donc quelque chose qui est de l’ordre de l’amour pour son analyste, et inconsciemment, il fait de celui-ci la cible de réactions affectives qu’il aurait pu avoir vis-à-vis de personnes qui ont joué un rôle importnat au cours de son enfance. (…) ce qu’il nous montre est ainsi le noyau de son histoire intime, « il le reproduit de façon palpable, présente, au lieu de s’en souvenir (S. Freud) ».
Transfert dissocié :
Modalités du transfert psychotique (Oury)
Ginette Michaud (2009) : « le transfert est toujours présent, mais il a d’autres façons de se signifier que dans la cure avec les névrosés. Il se manifeste surtout à travers la dissociation des énoncés (…) les énoncés dissociés peuvent se présenter, soit sous forme verbale, le « dire », soit sous forme d’actes au sens obscur, soit sous forme de production d’objets apportés ou non au thérapeute. »
Avec les névrosés, « le transfert permet d’aborder défenses et résistances qui se manifestent dans le travestissement des discours ». Cela suppose une nette séparation entre le moi et les objets, et donc la possibilité de symboliser. Pour le psychotique rien de tel, « l’objet n’existe pas comme chose à l’extérieur de soi, peuplant le monde et avec lequel on peut avoir un lien affectif ». Il ne peut donc pas transférer sur un seul psychanalyste comme cela se pratique dans la névrose. « En revanche (…) avec l’équipe soignante qui l’accueille, il peut « instituer » d’une façon partielle, (…) des investissement s de divers ordres, sur des personnes, sur des choses, des espaces… »
(G. Michaud, « Transfert dissocié et objets dans la cure », la Clinique Lacanienne, n°15, 2009)
Cf. constellation transférentielle
Oury – « Freud disait que chez les schizophrènes, il n’y a pas de transfert. A la fin de sa vie, il en était un peu revenu. (…) du transfert, il n’y a que ça, on ne sait pas quoi en faire (…) il y a du transfert mais c’est par petits bouts. On voit bien ça dans la vie quotidienne – à condition de ne pas enfermer, ficeler le type – dans des rencontres, par hasard ; il y a des lieux privilégiés très investis. De même l’importance, pour certains schizophrènes mutiques, d’un chat. Le pied d’un arbre, ou bien la brume à 6h du matin. Pour le reste il n’y a plus rien. Tout est dissocié….la Spaltung, c’est dispersé.
Violence fondamentale (la) :
Bergeret, 1984 : « Pulsion primaire purement défensive. Ne vise pas un objet au sens propre, mais est avant tout destiné à protéger l’individu qui l’éprouve. Les passages à l’acte ne visent pas une victime pour ce qu’elle est, mais pour éloigner le danger qu’elle incarne. »
1 Braunstein, Néstor A. La jouissance. Un concept lacanien. Érès, 2005